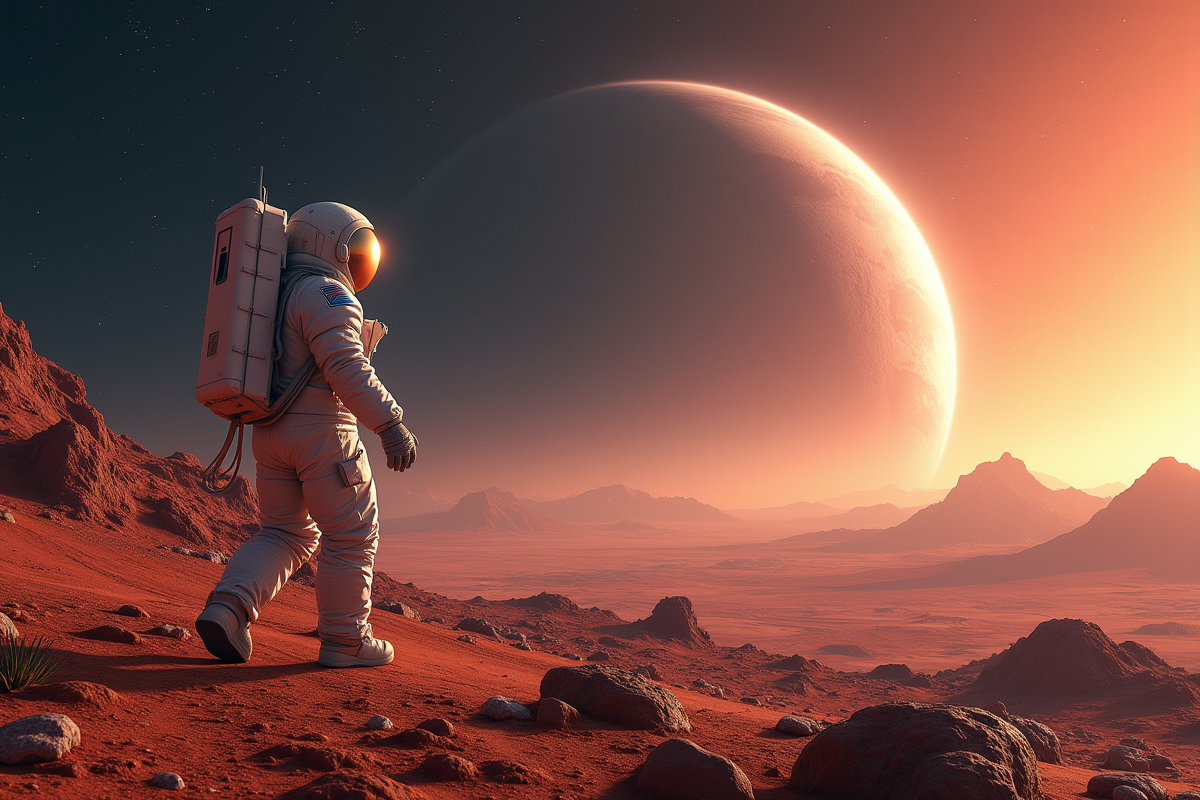Le brevet numéro 37435 déposé par George A. Smith en 1913 n’a jamais été cité dans les livres d’histoire sur la robotique. Pourtant, il propose un système de direction automatique pour véhicules motorisés, ignoré par l’industrie automobile de l’époque. En 1986, l’Université de la Bundeswehr à Munich fit circuler un véhicule contrôlé par ordinateur sur autoroute, défiant les prédictions des experts.
Entre brevets oubliés et démonstrations confidentielles, la paternité de la conduite autonome échappe aux réponses simples. Les jalons techniques et institutionnels se multiplient sans qu’un nom ou une date ne s’impose.
Aux origines de la conduite autonome : une ambition ancienne
Impossible de raconter l’histoire du véhicule autonome sans remonter à une époque où la voiture autonome n’existait que sur le papier, dans l’imagination d’inventeurs et de bricoleurs téméraires. Les archives regorgent de brevets visionnaires, obsédés par l’idée d’un déplacement sans intervention humaine. Dès le début des années 1900, certains rêvaient déjà d’un régulateur de vitesse, amorce d’une autonomie partielle. Si le nom de Benz revient souvent dans la conversation, l’impact de Mercedes-Benz se manifestera surtout après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’industrie automobile s’est décidée à prendre ce pari au sérieux.
Les années 1950 voient surgir des prototypes qui surprennent encore aujourd’hui : sur les grandes routes américaines, General Motors présente un « Firebird II » qui suit des câbles enfouis dans la chaussée. De l’autre côté de l’Atlantique, la France expérimente, en toute discrétion, des véhicules automatisés sur circuit fermé. Cette décennie marque un point de bascule : la conduite autonome n’est plus un fantasme, elle devient une affaire de laboratoires et d’ingénieurs convaincus que la machine peut dépasser la main humaine.
Voici quelques repères concrets de cette effervescence technique :
- Premiers brevets sur la direction automatique (1913)
- Prototypes de régulateurs de vitesse dans les années 1940-1950
- Expérimentations sur routes fermées en Allemagne et en France
À cette époque, la notion de véhicule autonome se décline à toutes les sauces : pour certains, il s’agit d’assister le conducteur ; pour d’autres, de l’effacer totalement. Les constructeurs se livrent à une course discrète, la voiture commence à se libérer de la présence humaine, étape par étape, sans révolution brutale. Ce terrain d’expérimentation continuera d’alimenter la fascination collective pour l’autonomie des machines.
Qui peut vraiment être considéré comme l’inventeur de la voiture autonome ?
Attribuer la conduite autonome à un seul inventeur relève d’un casse-tête. Les innovations s’empilent, chaque génération s’appuyant sur l’audace des précédentes. Avant que les géants de la Silicon Valley ne s’en mêlent, les premiers systèmes de conduite autonome se sont développés dans le secret des universités et des laboratoires publics, bien loin des projecteurs.
Dans les années 1980, l’université Carnegie Mellon se distingue avec son projet Navlab. Les équipes américaines font rouler leurs véhicules autonomes sur plusieurs kilomètres, prouvant que la fiction peut devenir réalité. Puis, au tournant du XXIe siècle, la DARPA, agence de recherche du Pentagone, chamboule la donne avec ses Grand Challenges, véritables tremplins pour la rencontre entre recherche académique et innovations privées.
La Corée du Sud n’est pas en reste. Un professeur coréen fait circuler, dès 1995, une voiture automatisée de Séoul à Busan, soit plus de 300 kilomètres avalés sans main humaine sur le volant. Ce trajet, dans un pays où la distance entre deux métropoles n’a rien d’anodin, frappe les esprits et installe la démonstration à grande échelle.
Plus récemment, Alphabet (maison mère de Google) accélère la métamorphose du secteur avec ses prototypes Waymo, héritiers d’une décennie de concours DARPA et de découvertes partagées. Impossible de trancher : le titre d’« inventeur » glisse de main en main, chaque avancée étant le fruit d’un écosystème où industrie, universités et nouveaux venus s’entremêlent.
Des technologies clés derrière l’autonomie des véhicules
Oubliez le mythe du génie solitaire : l’autonomie automobile est le résultat d’une alliance entre plusieurs technologies de pointe. Le système de conduite automatisée repose sur une architecture sophistiquée où chaque brique s’avère indispensable.
Tout commence par les capteurs : les caméras haute définition, les radars, les lidars. Ils explorent inlassablement l’environnement, lisent la signalisation, localisent les obstacles potentiels. Sans eux, la conduite hautement automatisée ne serait qu’un vœu pieux.
À ce socle matériel s’ajoute un cerveau numérique : l’intelligence artificielle. Des algorithmes nourris par des millions de scénarios réels analysent et interprètent la moindre situation. Cette capacité d’adaptation distingue les systèmes les plus récents, conçus par des entreprises comme Tesla, Google, Bmw ou Renault. Leurs véhicules ne suivent plus seulement un cap, ils anticipent l’imprévu, dialoguent avec l’infrastructure, s’adaptent en temps réel.
Voici quelques exemples concrets de ces innovations majeures :
- Régulateur de vitesse intelligent : il module la vitesse en fonction de la circulation, reléguant le régulateur classique au rang d’accessoire d’un autre temps.
- Logiciels de fusion de données : ils combinent les informations de tous les capteurs pour restituer une vue précise et fiable du trajet.
- Systèmes de transport intelligents : ils connectent la voiture à l’environnement urbain, optimisent les trajets, renforcent la sécurité.
Grâce à ces avancées, la conduite autonome sort du laboratoire et transforme la voiture en machine à la fois mobile et décisionnaire. L’industrie automobile franchit ainsi une frontière qui semblait, il y a peu, infranchissable.
Enjeux éthiques et défis de sécurité à l’ère des voitures sans conducteur
Dès les premiers tours de roue, la sécurité devient le centre de gravité des débats sur les véhicules autonomes. Les incidents impliquant des voitures sans conducteur déclenchent des réactions en chaîne, forçant autorités, constructeurs et chercheurs à redoubler de vigilance. La dimension technique n’explique pas tout : l’enjeu touche au partage de la responsabilité.
Demain, qui endossera la faute en cas de bug ou de décision algorithmique malheureuse ? Avec la conduite autonome, le conducteur humain s’efface, laissant la place à des lignes de code et à des protocoles élaborés dans l’urgence. Les assureurs, face à ces risques inédits, doivent réinventer leur modèle : le contrat d’assurance auto traditionnel peine à s’adapter à une voiture qui décide seule.
Questions majeures
Parmi les interrogations qui s’imposent, citons notamment :
- Quelle transparence sur les choix opérés par les algorithmes embarqués ?
- Comment garantir une alerte rapide en cas de défaillance des systèmes ?
- À qui incombe la faute en cas d’accident : au fabricant, au développeur du logiciel, à l’utilisateur, à la collectivité ?
Le déploiement des véhicules autonomes soulève aussi des questions de confidentialité, de surveillance des comportements et de gestion des événements imprévus sur la route. Les équipes de recherche multiplient les simulations, mais la réalité, complexe et mouvante, résiste encore à la certitude absolue. Jusqu’où sommes-nous prêts à confier la sécurité routière à la logique froide des machines ? Voilà le cap à franchir, ou à refuser.