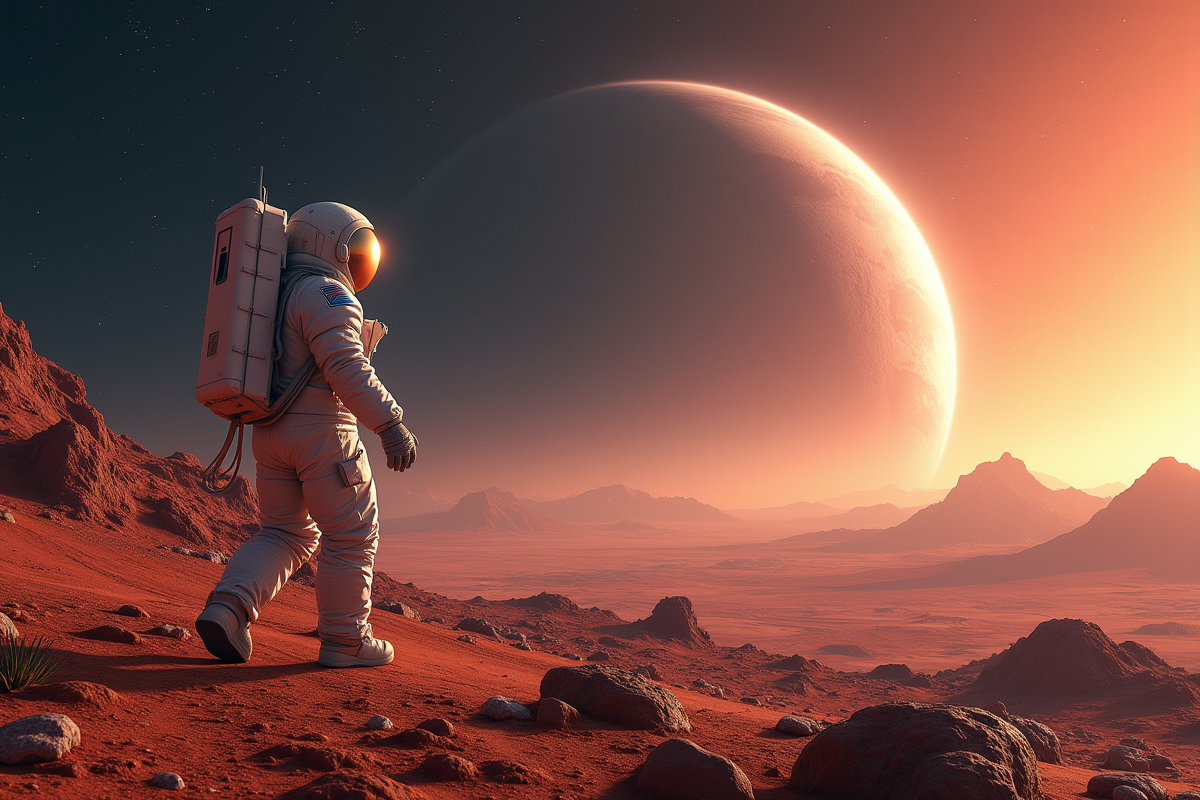En 1945, le gouvernement français met en place l’Office national d’immigration. La loi du 2 novembre 1945 fixe pour la première fois un cadre administratif à l’entrée et au séjour des étrangers. En moins de dix ans, la population immigrée en France augmente de plus d’un million de personnes, principalement en provenance d’Europe du Sud et d’Afrique du Nord.L’État organise alors le recrutement de main-d’œuvre étrangère pour répondre aux besoins de reconstruction. Le contexte économique, politique et social façonne les flux migratoires et les conditions d’accueil, dessinant les contours d’une nouvelle réalité démographique.
Comprendre les grandes étapes de l’immigration en France depuis 1945
À la sortie de la guerre, la France change de visage. Le pays relève la tête, obsédé par la nécessité de rebâtir, d’aller vite, de répondre à l’urgence sociale et économique. Pour mener ce chantier, l’État prend la main : l’ordonnance du 2 novembre 1945 donne à la puissance publique le contrôle sur l’entrée des étrangers, leur accueil, leur séjour. Le pays veut des bras, du renfort pour ses usines, ses chantiers, ses mines. De 1946 à 1975, la population immigrée s’envole : l’INSEE compte 1,7 million d’immigrés au lendemain de la guerre ; ils seront 2,8 millions trois décennies plus tard. Italiens, Espagnols, Portugais, Maghrébins quittent leur pays pour participer à la reconstruction française.
Le grand tournant surgit au milieu des années 70. En 1974, le gouvernement ferme la porte à l’immigration de main-d’œuvre. Le flux ne s’arrête pas, il se transforme : le regroupement familial prend la relève. L’asile prend de l’ampleur. Les débats s’enflamment autour de l’intégration, de l’identité, des valeurs françaises. La société s’interroge, se tend, hésite entre rejet et ouverture. Certains accèdent à l’ascension sociale, des associations émergent pour défendre les droits des immigrés et rappeler tout ce que ces familles apportent à la France.
Décennie après décennie, la statistique révèle ses évolutions : les villes s’étendent, les quartiers populaires se dessinent. On construit à grande vitesse les HLM, les ZUP, mais on découvre aussi la réalité des séparations urbaines et sociales. Les politiques publiques cherchent l’équilibre entre intégration et réduction des inégalités, sans jamais trouver de solution magique.
Voici les leviers principaux qui décident de la succession des vagues migratoires :
- Facteur économique : la machine industrielle réclame une main-d’œuvre abondante pour tourner à plein régime.
- Facteur familial : après le verrou de l’immigration de travail, la famille devient le moteur dominant des entrées sur le territoire.
- Facteur politique et colonial : bouleversements dans les ex-colonies, arrivée de réfugiés, liens historiques forts avec l’Afrique et l’Asie modèlent les profils des nouveaux venus.
L’histoire migratoire se façonne entre oppositions et nécessaires compromis, éclaire les débats de société et interroge le pacte social. Diversité, cohésion, égalité des chances : ces thèmes sont au cœur de la modernité française, portés à chaque génération de nouveaux habitants.
Pourquoi la France a-t-elle connu une première vague d’immigration après la Seconde Guerre mondiale ?
À la Libération, la France sort meurtrie, lessivée par la guerre. Routes, logements, infrastructures : tout est à refaire. Les pertes humaines pèsent lourd, la population vieillit. Il manque des bras pour relancer la production et bâtir des logements neufs. L’État prend le sujet à bras-le-corps avec l’ordonnance de 1945, qui organise et centralise l’arrivée de travailleurs étrangers.
L’Office national d’immigration orchestre ce flux : on fait venir surtout des Italiens, des Espagnols, des Portugais ; le Maghreb, déjà lié par la colonisation, s’ajoute au mouvement. Ces travailleurs font tourner les mines, élèvent les murs des nouveaux logements, alimentent les usines. L’urgence du pays est nette : grandir vite, produire, exister.
Trois dynamiques éclairent cette séquence :
- Le facteur économique : la France doit faire face à une pénurie évidente de main-d’œuvre, notamment peu qualifiée.
- Le facteur politique : de l’autre côté des frontières, la guerre civile espagnole ou la montée de dictatures obligent de nombreux Européens à prendre le chemin de l’exil.
- L’héritage colonial : les liens construits pendant la période coloniale rendent l’arrivée des Maghrébins plus facile sur le plan administratif.
Les chiffres s’envolent : l’INSEE mesure la montée rapide de la population immigrée. Les quartiers se redessinent, des débats surgissent, parfois houleux, aux abords des usines, des écoles, des marchés. Sans eux, la France ne connaît pas la même relance économique. Sans eux, la physionomie des villes ne serait pas la même, ni l’histoire du pays.
Portraits et trajectoires : qui étaient les premiers arrivants et d’où venaient-ils ?
Regardons plus près. Qui compose cette vague d’après-guerre ? On croise des jeunes venus d’Italie, d’Espagne, du Portugal, de Pologne, de Belgique, d’Allemagne. Beaucoup voyagent seuls, quittant un village ou une campagne pour tenter leur chance en France, dans l’espoir d’un travail stable, même pénible. Les Espagnols fuient la dictature, certains fuient la misère, d’autres rêvent simplement d’un autre destin que celui promis par leur région d’origine.
Le Maghreb suit, guidé par l’histoire coloniale. Algériens, Marocains, Tunisiens remplissent les bassins industriels français, parfois logés dans des conditions précaires, rassemblés par nationalité ou par entreprise. Les Portugais changent aussi le visage des grands chantiers, épaulent la production industrielle. Les femmes, d’abord peu nombreuses, viennent peu à peu rejoindre l’aventure, que ce soit comme employées de maison, ouvrières ou pour rejoindre mari et famille.
L’INSEE dessine un paysage humain multiple : dans les années 50, les Italiens dominent numériquement, suivis des Espagnols et des Polonais. Les flux venus d’Afrique subsaharienne, d’Asie ou de Turquie restent encore marginaux, mais cela changera plus tard. Le peuplement s’étend dans certains départements, Loiret, Indre-et-Loire, Cher, et s’inscrit durablement dans les périphéries urbaines où naîtront les quartiers populaires contemporains.
Pour approfondir : ressources et pistes pour explorer la diversité culturelle française
La diversité de la France ne se résume pas à une liste de nationalités. Elle vibre dans les rues de Lyon, Paris ou Marseille, dans le croisement des langues, des plats, des accents, des traditions que les vagues migratoires continuent d’apporter à l’espace public.
Associations, luttes et mémoire collective
Pour comprendre ce qui s’est construit en matière d’intégration et de défense des droits, quelques initiatives ont marqué leur époque :
- L’Association d’entraide nord-africaine (AENA), fondée par Sayah Chelaghendib à Tours, a offert bien plus qu’un accompagnement administratif : elle a tissé un lien entre générations, redonné une place à des invisibles, permis l’émergence d’une parole collective algérienne en France.
- La Marche pour l’égalité de 1983 : ce cortège a permis à toute une jeunesse française issue de l’immigration de réclamer respect, reconnaissance et justice. SOS Racisme, fondé à la suite de ce mouvement, structure encore le combat contre les discriminations.
Le regard de chercheurs comme Ralph Schor éclaire la transformation d’une société bouleversée par la diversité. De Nanterre aux quartiers de la Rabière, les politiques urbaines racontent l’intégration mais aussi les séparations, la vitalité et les blessures.
| Villes emblématiques | Dreux, Marseille, Chalette-sur-Loing, Rosières |
| Mouvements majeurs | SOS Racisme, AENA, Marche pour l’égalité |
Pour mieux saisir la complexité de cette fresque migratoire, statistiques officielles, archives locales ou récits littéraires permettent de mesurer l’impact des différentes migrations sur chaque territoire. L’histoire se lit dans les regards, les noms, la vitalité de chaque quartier. L’avenir de la France continue de s’écrire dans la diversité de ses habitants et la capacité de chacun à faire société avec l’autre.