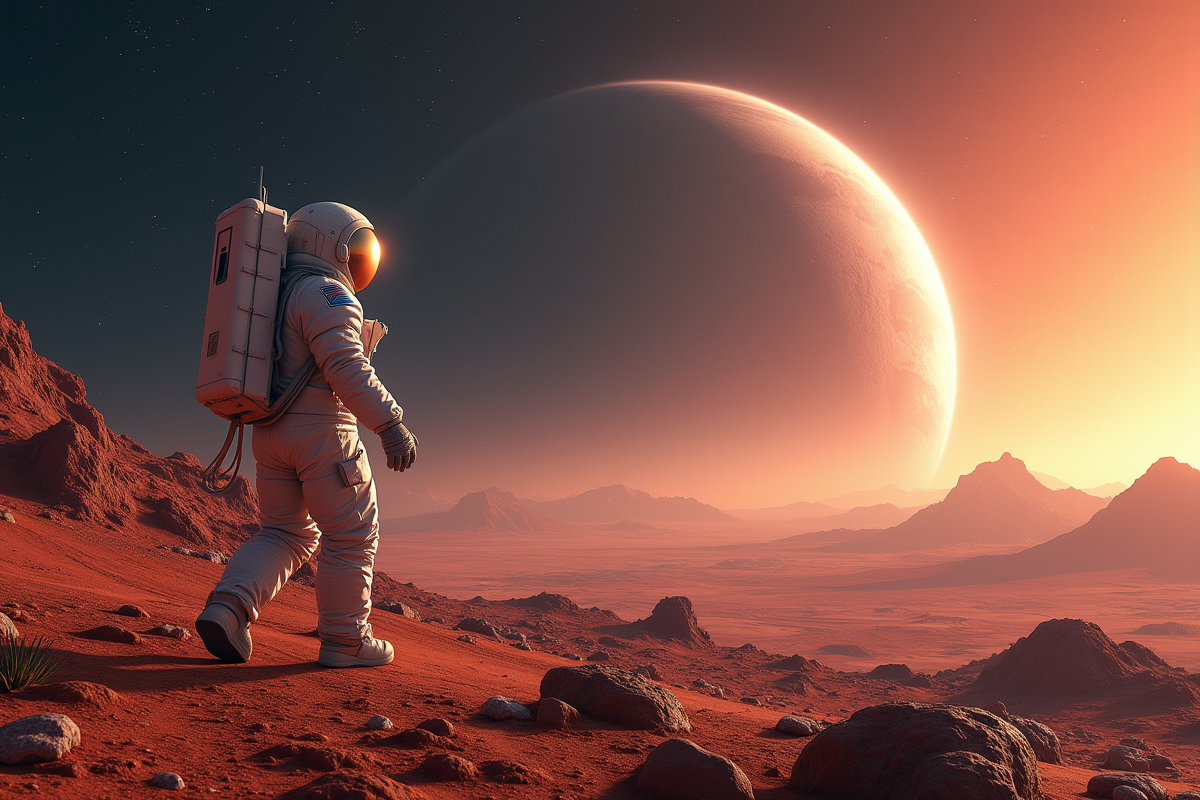Les chiffres ne mentent pas : depuis 2016, plus aucune négociation contractuelle ne se joue sans que la bonne foi ne plane sur les débats. L’article 1104 du Code civil s’est faufilé partout, imposant sa marque jusque dans la moindre clause d’un accord. Ce principe, désormais incontournable, bouleverse la façon de penser et de vivre le contrat.
Avec la loi de 2016, le droit des contrats a pris un nouveau virage. L’article 1104 ancre la bonne foi au cœur de toutes les étapes contractuelles : négociation, conclusion, exécution. Impossible d’y échapper, quels que soient le poids, l’expérience ou le secteur des parties concernées. Ce n’est plus seulement un vœu pieux ; c’est une exigence qui pèse sur chaque signature et chaque échange.
Ce que dit l’article 1104 du Code civil sur la bonne foi
L’article 1104 du Code civil érige la bonne foi en principe structurant du droit des contrats. Son texte tranche sans détour : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Tout est dit, ou presque. Ce devoir de loyauté s’impose de la première rencontre à la dernière échéance, sans exception ni privilège.
Parce qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public, aucune entente, aucune clause, ne peut y déroger. Le principe de bonne foi irrigue tout, du contrat sur-mesure au modèle pré-rempli, des relations commerciales les plus musclées aux engagements les plus anodins. Que l’on soit professionnel chevronné ou consommateur occasionnel, la règle s’applique, sans échappatoire.
Pour mieux cerner l’étendue de ce principe, voici les trois moments clés où il opère :
- La négociation du contrat, où chaque partie doit jouer cartes sur table et ne pas manipuler l’information.
- La formation du contrat, qui exige un consentement transparent et sans arrière-pensée.
- L’exécution du contrat, moment où l’on juge sur pièces la fidélité aux engagements pris.
L’article 1104 s’insère dans la logique d’ensemble du Code civil, en résonance avec d’autres articles qui protègent la confiance et l’équilibre des relations contractuelles. La jurisprudence veille : désormais, chaque manquement à la bonne foi peut être sanctionné, qu’il s’agisse d’un oubli délibéré ou d’une stratégie malhonnête. Ce texte devient un véritable rempart contre les pratiques déloyales et une garantie pour la stabilité des contrats.
Pourquoi la bonne foi s’impose-t-elle à toutes les parties contractantes ?
La bonne foi agit comme une boussole pour chaque acteur du contrat, sans distinction de force ou de vulnérabilité. Le Code civil n’en réserve pas le bénéfice aux plus fragiles : toute personne qui s’engage dans une relation contractuelle doit la respecter. Dès qu’un accord se profile, la loyauté devient non négociable.
Ce choix législatif s’appuie sur une idée : la liberté contractuelle ne se conçoit que dans un cadre loyal. Prenons un exemple concret : lorsqu’un vendeur dissimule sciemment une information décisive à son acheteur, il ne commet pas seulement une faute morale, mais viole une obligation d’information que la jurisprudence n’hésite plus à sanctionner, parfois sévèrement.
Les juges scrutent désormais chaque détail : échanges de courriels, silences calculés, démarches ambiguës. L’obligation de contracter de bonne foi ne permet plus les jeux de dupes ou les stratégies à courte vue. Qu’il s’agisse de négocier, de rédiger ou d’exécuter, la loyauté doit guider chaque décision.
Voici comment la bonne foi se traduit concrètement dans la pratique :
- La liberté contractuelle n’a de sens que protégée par la loyauté.
- La confiance réciproque entre les parties doit rester intacte.
- Tout acte de mauvaise foi, toute dissimulation ou manquement au devoir d’information, expose à des sanctions.
Ce principe infuse chaque type de contrat, du plus basique au plus complexe, et donne au juge le pouvoir de rééquilibrer la relation, bien au-delà des simples mots couchés sur le papier.
Employeurs et salariés : quels effets concrets de la bonne foi dans la relation de travail ?
Dans le contrat de travail, la bonne foi prend une dimension très concrète. Dès le recrutement, employeurs et salariés s’engagent dans une relation où la loyauté n’est pas accessoire. L’obligation de loyauté structure chaque interaction, du premier entretien jusqu’à la séparation.
L’employeur doit, lors de la négociation, fournir sans détour toutes les informations qui comptent : missions, contexte, conditions d’exercice. Le salarié, lui, doit être transparent sur ses capacités et ses limites. Si l’une des parties tente de biaiser la réalité ou de masquer une incompatibilité manifeste, la jurisprudence intervient, rappelant que la loyauté n’est pas négociable.
Une fois le contrat signé, la bonne foi continue de jouer son rôle. Le salarié doit accomplir ses tâches sans détourner les ressources de l’entreprise à des fins personnelles. L’employeur ne peut, de son côté, modifier unilatéralement les termes du contrat ou ignorer les droits du salarié. En cas de rupture, chaque étape doit respecter la loyauté : toute manipulation, abus ou dissimulation peut donner lieu à réparation.
Dans cette perspective, deux exigences se détachent nettement :
- Obligation de coopération : chaque partie doit veiller aux intérêts légitimes de l’autre, sans chercher à tromper ou à profiter d’une position dominante.
- Exigence d’information : tout élément déterminant doit être partagé, pour éviter les malentendus ou les pièges.
Au final, le droit du travail et le droit des contrats se rejoignent sur ce point : la bonne foi, loin d’être une abstraction, façonne la confiance et la stabilité de la relation professionnelle.
Réformes récentes et évolutions jurisprudentielles autour du principe de bonne foi
L’ordonnance de 2016 a donné un relief nouveau à la bonne foi, la propulsant sur le devant de la scène juridique. Les tribunaux, et notamment la Cour de cassation, ont précisé la portée de l’article 1104 du code civil : la bonne foi s’impose tout au long de la vie du contrat, de la négociation à la rupture. Ce n’est plus une simple référence éthique, mais une règle d’ordre public qui ne laisse aucune place à la manœuvre.
Des arrêts récents ont marqué un tournant. Lorsqu’une partie cache délibérément une information pendant la négociation, ce que l’on appelle la réticence dolosive, la sanction tombe : la nullité du contrat peut être prononcée. La jurisprudence distingue désormais clairement la responsabilité contractuelle (qui sanctionne la violation d’une obligation liée au contrat) de la responsabilité extracontractuelle (qui intervient en dehors du contrat). La première s’applique dès que la loyauté ou l’information font défaut ; la seconde, lorsque la mauvaise foi déborde du cadre contractuel.
La réforme a également introduit la gestion du changement de circonstances imprévisible. Si un événement bouleverse l’équilibre du contrat, une révision judiciaire peut être sollicitée, mais seulement si la partie qui demande l’ajustement a agi loyalement. Les juges examinent la bonne foi à chaque étape, y compris dans la rédaction des clauses les plus techniques.
Voici deux exemples récents qui illustrent cette évolution :
- Arrêt du 20 septembre 2017 (Cass. Civ.) : le devoir de loyauté s’impose dans la renégociation, notamment en cas d’imprévision.
- Arrêt du 24 octobre 2018 : la dissimulation volontaire d’une information lors de la formation du contrat est sanctionnée sans détour.
Le principe de bonne foi irrigue désormais toute la jurisprudence. Les professionnels du droit doivent s’y adapter, repenser la façon dont ils rédigent et négocient les contrats. Une nouvelle ère s’est ouverte : celle où la loyauté n’est plus une option, mais le passage obligé de toute relation contractuelle.